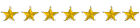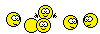(pour ma tite pop's  )
)
Quels sont
les caractères de l’expansion industrielle et urbaine ?
L’expansion industrielle
La révolution
industrielle a débutéen Grande-Bretagne, dès
la fin du XVIIe siècle. Portée par les progrès
de l’agriculture, qui libère de la main-d’oeuvre et
fournit des capitaux, elle est soutenue par l’expansiondu
commerce et du domaine colonial. Le véritable décollage
n’intervientcependant qu’à partir des années
1780 : la phase de croissance économique s’accélère,elle devient cumulative et irréversible.
L’avancée du
Royaume-Uni est considérable. Les pays européens
n’entrent dans ce type de développement que plus tard : la
France, dans les années 1830-1840 ; l’Allemagne (qui n’a
pas encore d’existence politique), 20 ans plus tard. À la
fin du XIXe siècle, ces pays ont rattrapé une grande
partie de leur retard, et deux pays extra-européens - les
États-Unis (vers 1840) et le Japon (après 1860) –
sont entrés dans la compétition.
Née d’initiatives
dispersées, mais qui toutes comptaient sur l’élargissement
des marchés et les progrès techniques, la révolution
industrielle anglaise a longtemps servi de modèle. Certains
historiens de l’économie pensent pourtant que dès le
Moyen Âge des progrès décisifs préfigurent
ce mouvement.
Il faut partir de la
machine à vapeur mise au point par Watt vers 1760. La première
grande industrie d’entraînementest le textile qui est
passé le premier de la phase artisanale à celle de
l’industrialisation, grâce aux nombreux progrès
techniques dans le filage, le tissage (navette volante, machine
Jacquard), la teinture. Ces progrès se sont appliqués
au coton, fourni en abondance par les colonies. D’autre part,
l’expansion de la marine à voile exigeait de grandes
quantités de toile. Mais c’est le chemin de fer, utilisant
la machine à vapeur et les rails, qui va tirer la croissance à
partir des années 1830-1840. Au début du XXe siècle,
l’automobile prend le relais : utilisez le terme de 2ème
industrialisation. Les industries d’entraînement s’inscrivent
dans un système : un progrès en appelle un autre. Le
chemin de fer sur rails, fourni en locomotives de plus en plus
performantes, exige des wagons qui s’adaptent aux courbes, des
rails moins sensibles à l’usure, ce qui amène le
développement de la sidérurgie. En accélérant
le transport, il permet la commercialisation lointaine des produits,
et crée de nouveaux besoins. Les lignes et le matériel
coûtent très cher, les banques, les sociétés
par actions se développent, mais l’intervention de l’État
est indispensable. Ce type d’enchaînement se retrouve pour
toutes les industries d’entraînement.
L’expansion
urbaine
Simultanément
l’Europe connaît une pleine expansion urbaine au XIXème
siècle. La précocité de l’urbanisation touche
en premier lieu le quart nord ouest du continent. Cette croissance
urbaine profite d’abord aux capitales (Londres, Paris et Berlin
dépassent le million d’habitants en 1900), mais aussi aux
cités industrielles et aux ports. Toutefois, la nouvelle
civilisation urbaine issue du progrès ne concerne encore que
les grandes villes. Les transports publics se développent sur
l’ensemble du siècle : omnibus à chevaux
généralisé en 1830, chemin de fer de banlieue en
1850, tramway hippomobile en 1870, trolley électrique en
1890, métro à paris en 1900 (ce n’est pas le
meilleur exemple car Paris est en retard par rapport à bien
d’autres villes ; citez plutôt Londres : 1863).
Petit à petit, la hiérarchisation sociale en ville
change. De verticale, selon l’étage habité dans
l’immeuble, elle devient horizontale avec le développement
anarchique des banlieues. Et tandis que l’on restructure avec soin
les centres ville (Paris, à partir de 1853, est percé
de grandes avenues par le baron Haussmann), des colonies de bicoques
sans équipements pullulent près des gares en banlieue.
Cette population de migrants venus des campagnes est non seulement
misérable, mais elle fait peur. Jusqu'à la découverte
de la théorie bactériologique mise en évidence
pour la tuberculose en 1882, les épidémies qui font des
ravages dans toutes les couches de la société (choléra
à Paris en 1832), sont expliquées par l’eau croupie,
l’air vicié, les eaux stagnantes, autant d'éléments
caractéristiques de la vie des pauvres. Et si l’essor urbain
accentue la pluralisation de la société avec
l’apparition de nouveaux métiers (vendeuse de grands
magasins, dame du téléphone), il n’empêche que
sur les boulevards éclairés à l’électricité,
deux mondes se côtoient. ( bourgeoisie et le
prolétariat).
A coté de la
transformation des grands centres anciens, des villes nouvelles
apparaissent et laissent voir des paysages urbains totalement liés
à la révolution industrielle. Particulièrement
nombreuses en Europe du Nord-Ouest, elles sont très peu en
Europe méditerranéenne et orientale. Ce sont des
paysages de mines et d’usines sur les gisements de charbon et de
fer, des paysages d’entrepôts dans les villes portuaires et
la présence d’autres usines encore le long des voies
ferrées. La vie des habitants des ces nouvelles cités
ouvrières est rythmée par le temps de travail en usine
(moyenne de 12 heures par jour au milieu du XIXè siècle).
Quels sont
les caractères de l’expansion industrielle et urbaine ?
L’expansion industrielle
La révolution
industrielle a débutéen Grande-Bretagne, dès
la fin du XVIIe siècle. Portée par les progrès
de l’agriculture, qui libère de la main-d’oeuvre et
fournit des capitaux, elle est soutenue par l’expansiondu
commerce et du domaine colonial. Le véritable décollage
n’intervientcependant qu’à partir des années
1780 : la phase de croissance économique s’accélère,elle devient cumulative et irréversible.
L’avancée du
Royaume-Uni est considérable. Les pays européens
n’entrent dans ce type de développement que plus tard : la
France, dans les années 1830-1840 ; l’Allemagne (qui n’a
pas encore d’existence politique), 20 ans plus tard. À la
fin du XIXe siècle, ces pays ont rattrapé une grande
partie de leur retard, et deux pays extra-européens - les
États-Unis (vers 1840) et le Japon (après 1860) –
sont entrés dans la compétition.
Née d’initiatives
dispersées, mais qui toutes comptaient sur l’élargissement
des marchés et les progrès techniques, la révolution
industrielle anglaise a longtemps servi de modèle. Certains
historiens de l’économie pensent pourtant que dès le
Moyen Âge des progrès décisifs préfigurent
ce mouvement.
Il faut partir de la
machine à vapeur mise au point par Watt vers 1760. La première
grande industrie d’entraînementest le textile qui est
passé le premier de la phase artisanale à celle de
l’industrialisation, grâce aux nombreux progrès
techniques dans le filage, le tissage (navette volante, machine
Jacquard), la teinture. Ces progrès se sont appliqués
au coton, fourni en abondance par les colonies. D’autre part,
l’expansion de la marine à voile exigeait de grandes
quantités de toile. Mais c’est le chemin de fer, utilisant
la machine à vapeur et les rails, qui va tirer la croissance à
partir des années 1830-1840. Au début du XXe siècle,
l’automobile prend le relais : utilisez le terme de 2ème
industrialisation. Les industries d’entraînement s’inscrivent
dans un système : un progrès en appelle un autre. Le
chemin de fer sur rails, fourni en locomotives de plus en plus
performantes, exige des wagons qui s’adaptent aux courbes, des
rails moins sensibles à l’usure, ce qui amène le
développement de la sidérurgie. En accélérant
le transport, il permet la commercialisation lointaine des produits,
et crée de nouveaux besoins. Les lignes et le matériel
coûtent très cher, les banques, les sociétés
par actions se développent, mais l’intervention de l’État
est indispensable. Ce type d’enchaînement se retrouve pour
toutes les industries d’entraînement.
L’expansion
urbaine
Simultanément
l’Europe connaît une pleine expansion urbaine au XIXème
siècle. La précocité de l’urbanisation touche
en premier lieu le quart nord ouest du continent. Cette croissance
urbaine profite d’abord aux capitales (Londres, Paris et Berlin
dépassent le million d’habitants en 1900), mais aussi aux
cités industrielles et aux ports. Toutefois, la nouvelle
civilisation urbaine issue du progrès ne concerne encore que
les grandes villes. Les transports publics se développent sur
l’ensemble du siècle : omnibus à chevaux
généralisé en 1830, chemin de fer de banlieue en
1850, tramway hippomobile en 1870, trolley électrique en
1890, métro à paris en 1900 (ce n’est pas le
meilleur exemple car Paris est en retard par rapport à bien
d’autres villes ; citez plutôt Londres : 1863).
Petit à petit, la hiérarchisation sociale en ville
change. De verticale, selon l’étage habité dans
l’immeuble, elle devient horizontale avec le développement
anarchique des banlieues. Et tandis que l’on restructure avec soin
les centres ville (Paris, à partir de 1853, est percé
de grandes avenues par le baron Haussmann), des colonies de bicoques
sans équipements pullulent près des gares en banlieue.
Cette population de migrants venus des campagnes est non seulement
misérable, mais elle fait peur. Jusqu'à la découverte
de la théorie bactériologique mise en évidence
pour la tuberculose en 1882, les épidémies qui font des
ravages dans toutes les couches de la société (choléra
à Paris en 1832), sont expliquées par l’eau croupie,
l’air vicié, les eaux stagnantes, autant d'éléments
caractéristiques de la vie des pauvres. Et si l’essor urbain
accentue la pluralisation de la société avec
l’apparition de nouveaux métiers (vendeuse de grands
magasins, dame du téléphone), il n’empêche que
sur les boulevards éclairés à l’électricité,
deux mondes se côtoient. ( bourgeoisie et le
prolétariat).
A coté de la
transformation des grands centres anciens, des villes nouvelles
apparaissent et laissent voir des paysages urbains totalement liés
à la révolution industrielle. Particulièrement
nombreuses en Europe du Nord-Ouest, elles sont très peu en
Europe méditerranéenne et orientale. Ce sont des
paysages de mines et d’usines sur les gisements de charbon et de
fer, des paysages d’entrepôts dans les villes portuaires et
la présence d’autres usines encore le long des voies
ferrées. La vie des habitants des ces nouvelles cités
ouvrières est rythmée par le temps de travail en usine
(moyenne de 12 heures par jour au milieu du XIXè siècle).